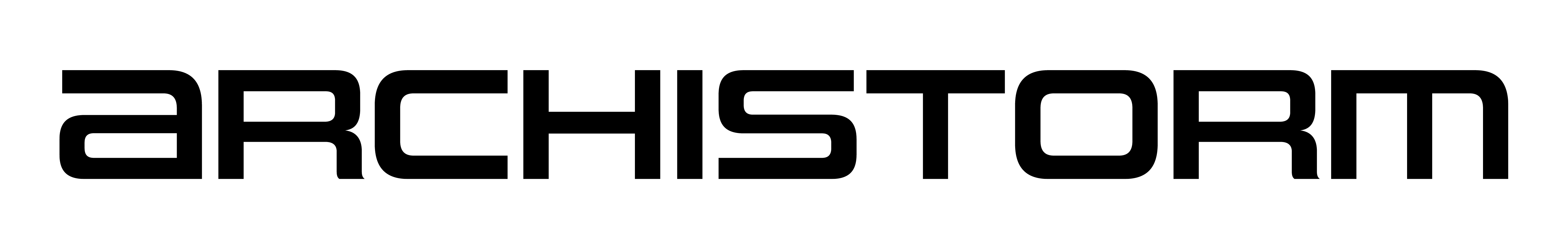Le Palais Rameau, œuvre architecturale lilloise du XIXe siècle, connaît un nouveau souffle grâce au projet de réhabilitation mené par l’Atelier 9.81 et Perrot & Richard Architectes pour l’école d’ingénieurs Junia. Cette transformation audacieuse allie respect du patrimoine et écoconception en bois, le projet créant un nouvel espace dédié à l’agriculture urbaine et à l’alimentation de demain selon le concept « de la fourche à la fourchette ». Le monument historique devient ainsi un espace hybride d’apprentissage, d’observation et d’expérimentation pour les étudiants.
Un héritage architectural
Le Palais Rameau, édifié en 1878 grâce au legs de Charles Rameau, président de la société lilloise d’horticulture, est un témoin remarquable de l’architecture de la fin du XIXe siècle. Conçu par les architectes lillois Auguste Mourcou et Henri Contamine, ce bâtiment mêle influences classiques et néo-byzantines, s’inspirant du principe d’une serre horticole. Au fil des années, le Palais Rameau connaît diverses utilisations, s’éloignant parfois de sa vocation initiale d’espace dédié aux expositions florales et artistiques. La municipalité de Lille, propriétaire du bâtiment, détourne effectivement sa fonction première dès le début du XXe siècle pour en faire un lieu de manifestations diverses : salon régional de l’automobile en 1926, centre d’examens pour les étudiants dès 1930, représentations de cirque à partir de 1987, élection de Miss France et salon culinaire en 2019, etc. Classé monument historique en 2002, il est partiellement rénové à l’occasion du projet « Lille Capitale Européenne de la Culture » en 2004, mais il faudra attendre 2025 pour qu’il retrouve son caractère originel grâce à une véritable réhabilitation d’envergure. L’occasion également de l’adapter aux enjeux contemporains pour ouvrir un nouveau chapitre. Pour Cédric Michel, architecte associé de l’agence lilloise Atelier 9.81, le projet fait honneur au legs de Charles Rameau en se plaçant dans la continuité de ses usages horticoles et artistiques d’origine.
Une restauration ambitieuse
En 2021, la ville de Lille, propriétaire du bâtiment, et Junia signent un bail de 25 ans, confiant la gestion du Palais Rameau à l’école d’ingénieurs. Cette collaboration donne naissance à un projet ambitieux visant à transformer le monument en un lieu dédié à l’enseignement supérieur spécialisé en agriculture et alimentation durable. Le projet architectural de l’Atelier 9.81 s’articule autour de la restauration et de la mise aux normes de l’édifice classé dans un premier temps, puis de l’intégration d’espaces neufs de recherche et d’expérimentation dans un second temps. L’objectif des architectes est alors de « remettre le bâtiment dans un état antérieur, le plus proche de son état d’origine fin XIXe siècle ». En effet, au cours de son utilisation, le Palais a été « dégradé » : lors d’une grande campagne de travaux de réfection en 1954, les deux bulbes surmontant les tourelles avaient été remplacés par des pyramidions, les verrières en toiture et la grande serre recouvertes de zinc. Les travaux ont permis à la rotonde de retrouver son lanterneau, la façade principale sa coiffe d’origine avec la pose des bulbes de 1 800 kg chacun, et une partie des douze verrières ont désormais un vitrage inondant la nef de lumière naturelle. La moitié du budget global a ainsi permis de restaurer partiellement l’édifice, quelques arbitrages laissant la possibilité de travaux ultérieurs si nécessaire.

Un projet en contact
En 2019, Junia lance une consultation sans programme défini et les architectes sélectionnés de l’Atelier 9.81 accompagnent l’école dans la définition des usages. Pour s’adapter à plusieurs cas de figure, trois axes stratégiques sont développés : la réversibilité, la modularité et la sobriété. En tenant compte des enjeux patrimoniaux du site, les architectes proposent un projet réversible pour anticiper l’avenir. « Ce qui nous a importé, c’est d’être toujours dans une forme de distance respectueuse face à l’existant, d’aller chercher le contact mais avec délicatesse » dévoile Cédric Michel. Une solution d’aménagements intérieurs détachés de l’enveloppe du monument historique est conçue dans l’idée de pouvoir la démonter entièrement et restituer le Palais Rameau dans son état d’origine. Un système de structure poteaux-poutres et de cloisonnements composés de modules démontables prend place sur un plancher technique posé lui-même sur maillage de micropieux de part et d’autre de la nef. La modularité de cette structure accompagne le programme avec deux travées en rez-de-chaussée comprenant l’accueil, le restaurant, des laboratoires, des fablabs de production, etc. Au centre, l’espace libre peut accueillir des expositions, conférences et autres événements publics. Le premier étage regroupe notamment les salles de classe et de réunion ainsi que d’autres laboratoires. Tout en haut, une mezzanine offre un espace polyvalent supplémentaire aux étudiants. Pour chaque usage, les cloisons modulaires peuvent être vitrées ou pleines en bois. Et pour que les fonctions puissent évoluer facilement, tout a été dimensionné à 450 kg/m2 – alors que les salles de classe et bureaux peuvent se contenter de 250 kg/m2 : un surcoût que Junia est prêt à assumer pour plus de flexibilité à long terme. Enfin, la sobriété, elle, passe une « exemplarité environnementale » selon Cédric Michel, à l’aide d’une approche circulaire « cradle-to-cradle » (du berceau au berceau) et du développement des filières locales durables.
Une approche circulaire
L’Atelier 9.81 a adopté une approche « cradle-to-cradle » en collaboration avec le bureau d’étude et de conseil Lateral Thinking Factory : il s’agit d’une approche d’écoconception qui vise à créer des produits et des systèmes dont les matériaux circulent en boucles fermées ou ouvertes, maintenant leur qualité et leur valeur à travers des cycles de vie successifs, tout en optimisant les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Les architectes ont donc privilégié des matériaux durables et recyclables comme la fibre de bois, la laine de bois ou encore le Fermacell® (panneaux de fibres-gypse facilement recyclables). La structure en bois, réalisée par la scierie Alglave et l’entreprise Edwood, se veut biosourcée et décarbonée. Quand l’ossature est réalisée en peuplier lamellé-collé issu de la filière régionale des Hauts-de-France, les planchers sont constitués de panneaux CLT fabriqués à partir d’épicéa, capables de résister à de fortes charges d’exploitation. Les modules, qui suivent une trame de 4,10 mètres par 7 mètres, optimisent l’utilisation du bois et minimisent les chutes en atelier. À l’extérieur, un parc de 6 000 m², accessible au public en journée, sert à la fois de lieu d’expérimentation pour les étudiants et de vitrine pédagogique sur la biodiversité urbaine.
Le Palais Rameau, réhabilité par l’Atelier 9.81 et et Perrot & Richard Architectes pour Junia et dont l’inauguration a eu lieu début février 2025, se transforme en un centre d’innovation et de recherche en agriculture urbaine, alliant patrimoine historique et enjeux contemporains à destination des futurs ingénieurs.

Entretien avec Cédric Michel, Architecte urbaniste, Cofondateur avec Geoffrey Galand en 2004, Atelier 9.81
Quels ont été les principaux défis techniques et patrimoniaux de la réhabilitation du Palais Rameau ?
Le principal enjeu a été d’insérer un programme contemporain dans un bâtiment classé, tout en respectant son intégrité. Cela a nécessité de nombreux échanges et négociations avec les architectes des bâtiments de France. Par exemple, pour intégrer les réseaux techniques sans endommager le bâtiment, nous avons créé un faux plancher de 60 cm au rez-de-chaussée. Cela a modifié les proportions d’origine, mais permet de préserver l’existant. La restauration des éléments patrimoniaux (vitrages, façades, etc.) a également été un chantier important. Nous avons dû faire des choix, comme la restitution des bulbes en toiture qui avaient disparu. Le défi était aussi thermique : le bâtiment est une passoire énergétique qu’on ne peut pas isoler. La solution a consisté à créer des « boîtes » en bois chauffées à l’intérieur.
Comment avez-vous intégré les enjeux de durabilité ?
Nous avons adopté une démarche globale sur le cycle de vie du bâtiment et des matériaux avec l’utilisation de matériaux biosourcés et locaux comme le peuplier. La Région (Fibois Hauts-de-France) a joué un rôle clé en finançant le delta de coût entre l’utilisation innovante de peuplier local et et celle de bois résineux standards, permettant ainsi ce choix architectural et le développement de la filière. Nous avons aussi privilégié le recyclage des éléments déposés quand c’était possible (vitrages envoyés à Saint-Gobain pour être recyclés). Et puis la conception modulaire et démontable permet l’évolution et le réemploi futur, ainsi que la sobriété dans les matériaux (pas de faux plafonds, réseaux apparents, etc.). Et enfin, le parc attenant sert aussi de zone d’expérimentation pour l’agriculture urbaine, avec des plantations comestibles.
Fiche technique :
Maîtrise d’ouvrage : JUNIA, Amexia (AMO)
Maîtrise d’œuvre : Atelier 9.81 et Perrot & Richard Architectes, Verdi Ingénierie (BET TCE), P2L (BE VRD), Elan (BE environnement), Lateral Thinking Factory (consultant économie circulaire), Les Saprophytes (paysagiste), EOV Elyne Olivier (historienne), REFL-EXE (OPC), Socotec (Bureau de contrôle), Bureau Veritas (CSPS)
Calendrier : 2019-2024
Surface : 3 950 m2 pour le Palais + 140 m2 pour la maison du gardien + 6 000 m2 de parc
Budget : 15,2 M € HT
Caractéristiques : démarche Cradle-to-Cradle. Classé au titre des monuments historiques. Développement de la filière bois locale (peuplier et épicéa)
Par Laurie Picout
Toutes les photographies sont de : © Nicolas da Silva Lucas
— Retrouvez l’article dans Archistorm 131 daté mars – avril 2025