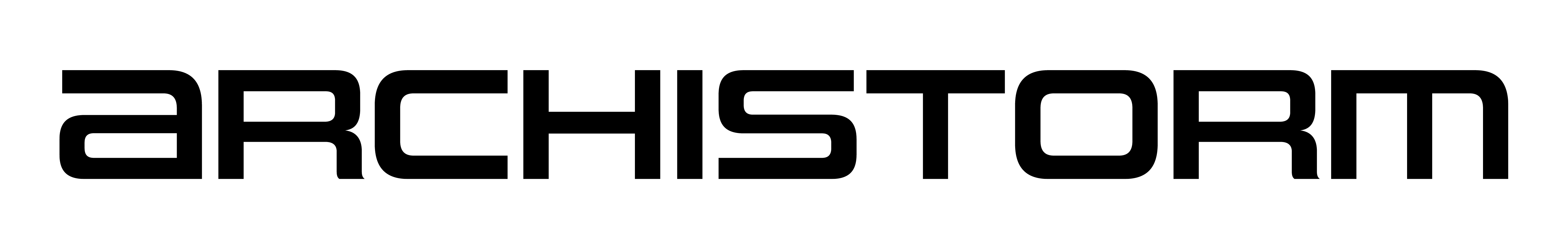Les résultats de l’enquête nationale sur la construction bois, publiés en juillet 2023 et portant sur l’année 2022, révèlent une dynamique impressionnante, malgré un contexte économique complexe. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 4,6 milliards d’euros HT en 2022, le secteur affiche une croissance notable de 14,3 % en valeur par rapport à 2020 et une augmentation de 5 % en volume.
Le marché, historiquement porté par la construction neuve (qui représente encore 73 % du chiffre d’affaires total), connaît une évolution notable : commanditaires et maîtres d’œuvre adoptent désormais le bois avec enthousiasme, les formes et les modénatures en bois se diversifient, donnant lieu à des créations toujours plus innovantes. En résumé, la construction bois ne se contente pas de progresser : elle redéfinit les codes de l’architecture contemporaine, en s’imposant comme un acteur clé de la transition écologique. Dans un monde en quête de durabilité, il semble clair que le bois continuera de tracer sa route vers le sommet du secteur du bâtiment.
Tour Wood Up : une icône pionnière de la construction bas carbone en Europe
S’élevant à 50 mètres de hauteur, la tour Wood Up, conçue par LAN Architecture, incarne une véritable révolution dans la construction bas carbone. Cette tour figure parmi les premières réalisations emblématiques de bâtiments verticaux à structure bois en Europe. Inscrite dans le cadre du projet urbain Paris Rive Gauche, orchestré par Yves Lion, elle parachève l’urbanisation du secteur est du 13e arrondissement de Paris, tout contre les Maréchaux et le périphérique. La base de l’édifice, réalisée en béton, accueille des commerces et une salle d’escalade, permettant d’englober les dénivelés complexes d’un site aménagé sur dalle. Ce socle robuste supporte les quatorze étages supérieurs, construits autour d’une imposante structure en bois complétée par un noyau central et des refends en béton. Visible et porteuse, l’ossature principale, composée de poteaux et de poutres en lamellé-collé, est renforcée par une trame extérieure secondaire, qui participe à l’esthétique globale. Les défis techniques n’ont pas manqué : les changements réglementaires constants, par exemple, ceux imposant l’encapsulation des structures extérieures bois, ont complexifié le projet. Cependant, Wood Up reste l’exemple d’une optimisation logistique et d’un approvisionnement durable. Tous les bois utilisés, d’origine française, ont été acheminés par voie fluviale via la Seine tandis qu’une sélection minutieuse des essences a permis de tirer le meilleur parti des propriétés spécifiques de chacune : le hêtre, utilisé pour les poteaux verticaux, assure une excellente résistance à la compression ; l’épicéa, choisi pour les poutres, se distingue par sa flexibilité ; enfin le Douglas, connu pour sa robustesse face à l’humidité, a été employé pour les éléments extérieurs. Wood Up ne se limite pas à son expérimentation sur la construction bois, la tour place aussi l’habiter au cœur de sa conception. Les 132 logements, allant du T1 au T5, sont répartis de façon stratégique pour encourager la mixité sociale. Les étages avec les petits logements alternent avec ceux accueillant les grandes superficies. Ainsi les espaces peuvent-ils être combinés verticalement, répondant aux besoins évolutifs des occupants. L’interaction entre habitants est également au centre de la vision architecturale. Plusieurs espaces communs, tels qu’une terrasse traversante de 300 m² au huitième étage, une toiture aménagée, un hall semi-couvert généreux et des circulations lumineuses, invitent à la rencontre et au partage. En prime, les chutes de bois issues de la construction ont été recyclées pour fabriquer des meubles destinés à ces lieux partagés, renforçant ainsi l’engagement écologique du projet.
Ode à la simplicité
Lorsqu’il est inscrit dans une démarche locale et respectant une traçabilité rigoureuse, le bois n’a plus à démontrer ses vertus écologiques.
Cette approche est pleinement incarnée par l’architecte Emmanuelle Weiss, qui privilégie l’utilisation quasi exclusive du bois et de matériaux biosourcés. Récemment, elle s’est vu confier la conception de la Maison de la transition écologique à Marcq-en-Barœul, près de Lille. Implanté sur une ancienne ferme maraîchère devenue musée, ce projet prend la forme d’une halle lumineuse et chaleureuse, où chaque détail technique reflète une philosophie low-tech.
L’architecture s’organise autour de douze portiques porteurs, mettant en avant une précision remarquable dans les assemblages et assurant une harmonie structurelle. « Je travaille avec des bois simples pour des raisons économiques et chaque élément est conçu pour minimiser les découpes. Le bois offre une flexibilité permettant des assemblages qualitatifs et favorisant l’inventivité à la fois formelle et structurelle », explique Emmanuelle Weiss. Son expertise découle d’une formation approfondie, où elle a exploré l’ensemble du cycle de vie du bois : de l’étude des forêts jusqu’à la mise en œuvre architecturale, incluant des réflexions transversales sur l’acoustique et les techniques de construction.
La richesse expressive des assemblages en bois
Dans la petite commune de Missillac, en Loire-Atlantique, le bois trouve une nouvelle dimension plastique avec la halle de marché conçue par LAUS architectes. Ce projet retisse la maille urbaine en requalifiant l’espace public : un parvis dégagé s’ouvre sur la rue principale, tandis qu’une venelle relie la halle à un cœur d’îlot en pleine mutation. Cette architecture, à la fois accueillante et intemporelle, se distingue par ses assemblages sophistiqués. Sa couverture en bardeaux de mélèze brut, scindée en ouïes, assure une ventilation hivernale et une respiration rafraîchissante en été. La charpente, tramée et dansante, mélange poteaux et arbalétriers dans un jeu de ciseaux qui brouille la distinction entre éléments porteurs et stabilisateurs. L’alternance des fermes, avec un retournement systématique d’une sur deux, génère une diversité rythmique qui enrichit la répétition.
De son côté, le Pavillon Jardins, imaginé par Atelier du Pont et situé au cœur du parc de La Villette à Paris, met en scène une autre approche des assemblages bois. Ce bâtiment de 3000 m², destiné à rassembler les équipes du Parc et de la Grande Halle autrefois dispersées, s’inscrit dans une trame orthogonale pensée pour s’adapter aux évolutions futures. « Nous avons conçu une structure générique, composée de poutres et de poteaux en bois, offrant des portées de douze mètres. Un noyau en béton garantit le contreventement et l’inertie nécessaires. Le tout, entièrement décloisonnable, est organisé autour d’un atrium central », explique Philippe Croisier, cofondateur de l’Atelier du Pont avec Anne-Cécile Comar. Mais « générique » ne signifie pas banal. Le bâtiment, finement proportionné, dévoile une ossature en bois dont les assemblages minutieux apportent légèreté et raffinement. Les poteaux sont divisés en quatre éléments lamellés-collés de 16 x 16 cm, tandis que la verrière centrale, inspirée par la simplicité ludique d’un jeu de Kapla, illustre une maîtrise architectonique remarquable. Vitré sur toute sa hauteur, le Pavillon Jardins établit un dialogue subtil avec son environnement naturel. Ces réalisations démontrent que l’architecture bois ne se limite pas à une esthétique rustique ou bucolique. Au contraire, les détails minutieusement étudiés permettent une intégration réussie dans le contexte métropolitain et urbain.
Une contribution majeure aux débats écologiques contemporains
Le débat sur l’écologie de la construction s’oriente de plus en plus vers la préservation et la transformation des structures existantes, plutôt que vers leur démolition systématique. Le bois, par sa flexibilité, sa légèreté et sa durabilité, joue un rôle clé dans cette évolution, s’inscrivant avec audace dans des projets innovants. Prenons l’exemple de la transformation d’une ancienne ferme en deux foyers d’habitation à Saint-Martin-Lestra, en
Auvergne-Rhône-Alpes, une région leader de la construction bois en France. Ce projet atypique, mené en autoconstruction par l’architecte propriétaire – Loïc Parmentier de l’Atelier de Montrottier –, conjugue créativité et respect du patrimoine. Un volume orthonormé en bois tressé contemporain s’élève au-dessus du soubassement originel. Ce choix architectural réinterprète les stabulations environnantes en introduisant une trame régulière et légère. La charpente en bois local intègre une coursive orientée au sud, optimisant les apports solaires thermiques en toute saison.
Le confort thermique est en outre assuré par un puits canadien provençal couplé à une ventilation double flux passive. L’ancienne charpente et des briques de terre cuite ont été réemployées pour renforcer l’inertie intérieure, démontrant que rénovation et innovation peuvent aller de pair.
Non loin de là, dans le massif des Churfirsten, en Suisse, les architectes de Herzog & de Meuron ont offert une seconde vie à la station de téléphérique de Chäserrugg, datant des années 1970. Cette structure métallique générique, ancrée sur des fondations en béton, a été métamorphosée grâce à l’ajout de façades en bois et d’un nouveau volume arrière abritant un restaurant panoramique spectaculaire. Privilégiant des matériaux locaux, les éléments en bois ont été préfabriqués dans la vallée et assemblés sur place en un été. Le choix exclusif du bois, motivé par une volonté d’honorer les traditions locales, confère au bâtiment une expressivité plastique remarquable. Ces deux projets illustrent la pertinence du bois dans les grands débats actuels sur la construction durable. Qu’il s’agisse de préserver un patrimoine rural ou de réinventer une station alpine, ce matériau se révèle être un puissant vecteur de transformation architecturale.
Économie circulaire : le bois en réinvention
En parallèle des efforts pour préserver le bâti existant, la question du recyclage et du réemploi du bois s’impose comme un enjeu majeur. Le recours au bois récupéré ou recyclé offre une réponse efficace à la réduction de la demande en bois neuf, permettant de préserver les ressources naturelles tout en limitant les déchets de construction. Ce processus contribue également à atténuer l’impact environnemental de l’exploitation forestière, en réduisant les émissions de carbone, les risques pour la biodiversité et l’érosion des sols.
L’exemple de la pergola du village de Luotuowan, dans la province de Hebei en Chine, conçue par le studio LUO, illustre parfaitement cette démarche. Réalisée à partir de bois provenant de maisons démantelées, elle exploite des tiges de tailles variées pour l’ossature de l’abri. Plutôt que de retravailler le bois, les concepteurs ont pris en compte les variations de longueur, ajustant ingénieusement la position de chaque pièce. Une initiative renforcée par l’implication des villageois eux-mêmes dans les travaux, ajoutant une dimension communautaire et locale au projet.
À Londres, l’extension de la bibliothèque de Lea Bridge, réalisée par
Studio Weave, adopte une approche similaire. En priorisant la réutilisation des matériaux existants, le projet a intégré des panneaux et des mobiliers issus d’arbres abattus dans les rues et les parcs publics, tels que platanes, peupliers, sycomores et frênes. Cette diversité d’essences, conservant leurs variations de teinte naturelle, confère à la structure une grande richesse plastique.

Atelier du Pont Architectes, Pavillon Jardins, Paris La Villette © Charly Broyez
Potentiel et défis de l’économie circulaire du bois
Les perspectives pour l’économie circulaire du bois sont prometteuses. La préfabrication et l’assemblage modulaire, largement répandus dans la construction bois moderne, pourraient favoriser le réemploi de modules entiers, d’éléments structurels ou de composants spécifiques. Les assemblages à sec, majoritaires dans ce secteur, sont réversibles, permettant un démontage sans perte de valeur, une caractéristique qui distingue le bois des autres matériaux de construction. Cependant, des limites subsistent. Actuellement, seule une petite fraction du bois usagé est réutilisée dans la production, principalement pour des panneaux de particules. Le reste, destiné à des usages thermiques, est souvent brûlé après son utilisation initiale. Cette approche gaspille une ressource précieuse qui pourrait être exploitée de manière plus efficiente. Le concept d’un emploi « en cascade » du bois, consistant à maximiser son utilisation à chaque étape de sa transformation, reste encore largement sous-exploité. Pour répondre aux défis environnementaux actuels, il est essentiel de valoriser pleinement ce potentiel et d’encourager des pratiques de réemploi systématique dans la filière bois. Une transition qui pourrait transformer le bois en véritable modèle d’économie circulaire.
Entre promesses et contradictions
Le bois, matériau à la fois ancestral et contemporain, s’inscrit aujourd’hui au cœur des débats sur l’architecture durable. Si son utilisation semble répondre à une quête d’écologie et de responsabilité, ce renouveau n’est pas exempt de paradoxes. Porté par des techniques nouvelles et des avancées dans la préfabrication, le bois explore des territoires que l’on n’aurait pas imaginés il y a encore quelques décennies : gratte-ciels, infrastructures massives, ou encore constructions modulaires adaptées à des besoins flexibles. Ce regain d’intérêt redéfinit le leadership mondial, éclipsant même les Scandinaves, longtemps considérés comme les maîtres incontestés du matériau. Cependant, ce boom du bois soulève des questions complexes. D’abord, celle de son approvisionnement. Alors que le discours met souvent en avant l’idée d’une ressource locale et renouvelable,
la réalité est parfois bien différente. Dans certains projets, le bois est importé, parcourant des milliers de kilomètres avant d’être mis en œuvre, ce qui dilue largement son intérêt écologique. Ce manque de cohérence entre ambition environnementale et traçabilité interroge : à quel point peut-on encore parler d’une démarche durable lorsque l’empreinte carbone liée au transport ou à la transformation devient significative ? Ensuite, il y a le risque d’une surconsommation du bois, motivée par un effet de mode plus que par une réelle adéquation technique ou environnementale. La maîtrise d’ouvrage, désireuse de projeter une image vertueuse, cède parfois à l’instrumentalisation du matériau. Cela peut mener à des constructions « vitrines », où le bois devient un symbole plus qu’une solution réfléchie et contextuelle. Si ce phénomène permet de faire évoluer les mentalités, il peut aussi alimenter une dérive où le bois est utilisé là où d’autres matériaux seraient plus adaptés, en termes de coût, de performance ou de durabilité. Un autre point polémique concerne la réglementation. Alors que le bois est souvent mis en avant comme une réponse aux impératifs bas carbone, les règles d’encapsulation imposées dans certains contextes, notamment en résidentiel, neutralisent parfois ses bénéfices. Le recours à des traitements ou à des couches protectrices peut alourdir son impact environnemental, tout en limitant sa capacité à valoriser ses propriétés intrinsèques comme la respiration ou la régulation hygrométrique.
Enfin, il ne faut pas oublier les enjeux sociaux liés à ce matériau.
La filière bois pourrait devenir un levier économique puissant, notamment pour les zones rurales où la sylviculture et la transformation locale pourraient redynamiser des territoires en déclin. Toutefois, cela suppose un engagement clair en faveur de la formation, de la revalorisation des métiers manuels, et surtout d’une régulation stricte pour éviter une
exploitation excessive des forêts françaises et européennes.
Vers une vision nuancée de l’avenir
Pour que le bois tienne réellement ses promesses, il faut dépasser les simples discours et aborder le matériau avec pragmatisme. Cela signifie s’interroger en profondeur sur la pertinence de son utilisation dans chaque projet, favoriser les circuits courts, et encourager une économie circulaire du bois à travers le réemploi et la réparation des structures. De plus, il devient crucial de sensibiliser les acteurs du bâtiment à une utilisation juste et ciblée, en intégrant le bois comme une solution parmi d’autres, et non comme une panacée universelle. Le bois ne doit pas être le seul matériau de la transition écologique, mais il peut en être une pièce essentielle, à condition que son emploi reste ancré dans une réflexion locale et durable. Dans un monde en quête de solutions face à l’urgence climatique, il est temps d’abandonner l’idéalisation naïve pour une approche équilibrée, où chaque matériau trouve sa juste place.
Par : Sophie Trelcat
Visuel à la une : Atelier du Pont Architectes, Pavillon Jardins, Paris La Villette © Charly Broyez
— Retrouvez l’article dans Archistorm 130 daté janvier – février 2025