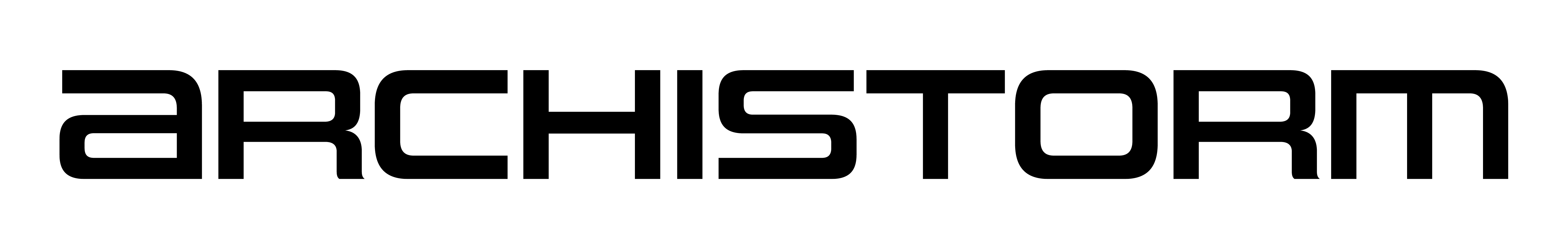La Métropole du Grand Paris, officiellement créée en 2016 après des années de concertation, ambitionne de rivaliser avec des mégapoles comme Londres ou New York. Ce projet, lancé en 2008 par Christian Blanc, incarne une nouvelle vision du territoire. Dans cet élan, le Grand Paris Express révolutionne la mobilité en connectant directement les pôles de vie des banlieues via un réseau de 68 gares conçues avec des artistes. Offrant davantage que l’infrastructure, ce projet intègre 500 œuvres d’art au cœur du quotidien des Franciliens. Les premières livraisons voient le jour.
L’inauguration, le 18 janvier dernier, de la station Villejuif-Gustave Roussy marque une nouvelle avancée dans la transformation des transports en Île-de-France. Située sur le prolongement sud de la ligne 14, entre Olympiades et Aéroport d’Orly, cette station représente un carrefour stratégique pour des millions de voyageurs. À quelques pas de l’Institut européen de recherche contre le cancer, qui lui donne son nom et qui génère 3 000 emplois, Villejuif-Gustave Roussy est appelée à jouer un rôle clé dans la mobilité régionale. Dès aujourd’hui, elle connecte les usagers à la ligne 14 et, dès 2026, elle sera également desservie par la ligne 15 Sud. Ce nœud de transports facilitera les trajets vers des sites stratégiques comme l’hôpital Gustave Roussy, l’aéroport d’Orly, le Marché d’Intérêt National de Rungis ou encore Châtelet. À terme, la station accueillera près de 100 000 voyageurs par jour, se positionnant ainsi comme la deuxième plus grande du réseau, juste après Saint-Denis Pleyel, inaugurée en juin dernier. Imaginée par l’architecte Dominique Perrault, la station Villejuif-Gustave Roussy se distingue par son audace architecturale et sa dimension artistique. Pensée comme un « connecteur entre le monde du dessous et celui du dessus », elle transcende la fonction classique d’une gare pour devenir un espace public d’exception. Sa toiture plissée, légère et transparente, semble flotter au-dessus d’un immense puits central habillé de résille métallique. Cette conception aérienne permet à la lumière et à l’air de circuler jusqu’aux quais, transformant chaque passage en une expérience à la fois fonctionnelle et esthétique. Descendre à 50 mètres de profondeur devient alors un véritable « voyage dans le voyage », avec des escalators et des escaliers monumentaux qui prolongent les dynamiques verticales de la ville en un espace spectaculaire, piranésien, taillé dans la chair du territoire. L’expérience sensorielle se prolonge grâce à l’artiste chilien Iván Navarro, dont l’œuvre, composée de 118 caissons lumineux et réfléchissants, rythme les plafonds des niveaux souterrains. Ces illusions d’optique, jouant sur la profondeur et les mouvements, transforment chaque instant en un moment poétique et immersif. Cette gare incarne le concept de « Groundscape » cher à Dominique Perrault et redéfinit la manière dont nous vivons et percevons les infrastructures de transport : elle connecte les usagers à une nouvelle vision du déplacement, où fonction et émotion se rencontrent.
Un bouleversement territorial
Considéré comme le plus grand chantier urbain d’Europe, le Grand Paris Express impressionne par des chiffres hors norme : 200 kilomètres de réseau composés de quatre nouvelles lignes de métro et de plusieurs extensions de lignes existantes. Ce projet gigantesque, représentant un investissement de 28 milliards d’euros, vise à révolutionner les déplacements en Île-de-France. Grâce à ses 68 gares, les trajets de banlieue à banlieue seront considérablement réduits, évitant le passage souvent contraignant par le réseau concentrique parisien. Les bénéfices de ce projet ne s’arrêtent pas là. Les aéroports d’Orly, de Roissy et du Bourget seront désormais accessibles en moins de 30 minutes grâce aux transports collectifs, reliant efficacement ces hubs stratégiques à toute la région. En parallèle, la construction des nouvelles lignes de métro automatiques aura un effet catalyseur sur les territoires desservis. Ces zones bénéficieront d’une restructuration urbaine majeure, accompagnée de la création de nouveaux quartiers, sur une superficie totale équivalente à une fois et demie celle de Paris intramuros. L’impact sur la mobilité et l’urbanisme sera colossal. À terme, la surface du réseau métro sera doublée, bouleversant le rapport entre la capitale et sa périphérie. L’actuel modèle centripète, où tout converge vers l’hypercentre, laissera place à une vision plus diffuse et connectée : celle d’une « ville archipel ». Ce bouleversement géographique, qui réorganise en profondeur les dynamiques territoriales, rappelle l’impact historique qu’avait eu le percement du premier réseau de métro souterrain il y a plus d’un siècle.
Une marque de fabrique
Dès ses débuts, le métro parisien illustrait une ambition unique : marier performance technique et expression artistique. En 1900, la Compagnie du chemin de fer Métropolitain de Paris (CMP), insatisfaite du manque d’originalité des projets proposés pour l’identité visuelle du métro, se tourne vers un jeune architecte novateur, Hector Guimard, fervent représentant de l’Art nouveau. Chargé d’imaginer une esthétique emblématique pour le réseau, Guimard transforme le métro en une œuvre d’art urbain. Il donne libre cours à son style « coup de fouet » pour concevoir les édicules, les entourages, la signalétique et les pavillons marquant les entrées des souterrains. À travers ces créations, Guimard imprime une triple signature inimitable : la sienne, celle du métropolitain et celle de Paris. Parmi les 167 ouvrages réalisés à l’époque, 88 ont été préservés. Ces structures, faites d’éléments en fonte moulurée, continuent aujourd’hui de symboliser l’identité visuelle du métro et d’ancrer l’Art nouveau dans le paysage parisien.
La question de l’ancrage local et du lien territorial est au cœur du projet du Grand Paris Express, nécessitant une approche subtile : « Outre notre ambition structurelle de transformation, nous avons l’ambition culturelle de construire un imaginaire commun », déclarait José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique du GPE. Il ajoutait : « Dans les gares, les œuvres d’art seront sublimes, tant d’un point de vue créatif que dans leur relation avec le public ». En effet, ce projet hors norme ne se limite pas à transformer la mobilité urbaine : il redéfinit également le rôle de l’art dans l’espace public. Ce qui rend cette initiative exceptionnelle, au-delà de son ampleur et de son impact sur la ville, c’est son processus d’implication artistique unique. Les œuvres permanentes qui s’installeront dans les gares sont le fruit d’une collaboration étroite entre deux univers créatifs : architectes et artistes travaillent en tandem, dès les premières phases du projet. Ce mode de co-conception va bien au-delà du traditionnel « 1% artistique » souvent relégué à la touche finale des chantiers.

Future station de La Courneuve, ChartierDalix © Société des Grands Projets
Entre mémoire et renouveau
Les quartiers autour des gares du Grand Paris Express seront des lieux de rencontre entre héritages locaux et identités en devenir, des espaces où de nouvelles histoires s’écrivent tout en renouant avec le passé. C’est dans cet esprit qu’a été imaginée la future gare de La Courneuve, dont la livraison est prévue en 2026. Pour cette réalisation, le duo d’architectes ChartierDalix s’est associé à l’artiste Duy Anh Nhan Duc. Tous deux partagent cette ambition : retisser les liens entre la ville et la nature tout en réactivant la mémoire de ce territoire. Longtemps marquée par les infrastructures et l’industrialisation, La Courneuve regorge de potentiels inexploités. Ses grandes bâtisses industrielles, chargées d’histoire, offrent des opportunités de reconversion en institutions publiques. À seulement 300 mètres de la future gare se trouve le Parc Georges Valbon, l’un des plus vastes espaces verts d’Île-de-France. S’inspirant de ce passé et de cette proximité avec la nature, les architectes revisitent la voûte originelle du métro parisien en utilisant la brique, matériau emblématique de l’industrie locale, et imaginent une gare profondément ancrée dans son environnement.
La symbolique de cette gare se déploie dans son architecture : ses façades, colonisées par une végétation luxuriante, s’ouvrent sur une toiture qui accueille une forêt dense. Cette nature extérieure pénètre l’intérieur de la gare grâce à la vision poétique de Duy Anh Nhan Duc. Lui-même lié à ce lieu depuis l’enfance, où il explorait le Parc de La Courneuve, l’artiste a récolté une multitude de végétaux provenant du parc, choisis pour leur richesse formelle et leur capacité à inspirer la rêverie. Séchées et encapsulées dans des résines transparentes, ces plantes composent les parois de la gare souterraine, donnant l’impression que la nature flotte dans les airs et accompagne les voyageurs dans leur descente vers les quais. Au plafond, l’artiste a créé une installation unique en plaques de laiton, où s’entrelacent les lignes agrandies des mains d’usagers du parc. Ces empreintes, moulées et collectées auprès des habitants, forment une fresque collective symbolisant les histoires et les mémoires individuelles. Ce mariage entre végétal et humain, passé et présent, fait de la gare de La Courneuve un lieu de récit et de connexion profonde entre la ville, ses habitants et leur environnement.
Agora urbaine et vides sublimés
À Clichy-Montfermeil, l’architecte catalane Benedetta Tagliabue imagine une grande agora urbaine située sur la place du marché constituant le cœur vibrant du quartier. Au centre de son projet se déploie une nappe métallique légère et colorée, inspirée des textiles chatoyants qui reflètent la richesse et la diversité culturelle de ce territoire monde. Sous cet élégant abri – qui accueille la station (ouverture en 2026) – une fresque monumentale en grès cérame vient marquer les esprits. Elle est signée JR, artiste mondialement reconnu et enfant du quartier. Avec cette œuvre, JR revisite l’histoire de Clichy-Montfermeil à travers un montage de portraits de 850 habitants, pris en 2016. Ces visages, qui racontent la vie et les histoires des lieux, deviennent un miroir de la population locale, immortalisant l’âme de ce territoire pour les générations futures.
À la gare de Saint-Maur Créteil (ouverture en 2026), conçue par Cyril Trétout, la descente vers les quais devient une expérience saisissante. Un gigantesque escalier central, semblant flotter dans le vide, relie l’espace public au niveau des quais dans un mouvement spectaculaire et aérien. Cet espace, déjà impressionnant par son architecture, est sublimé par l’intervention de l’artiste Susanna Fritscher. Elle y intègre, sur toute la hauteur, des trames filaires fines et vibrantes, parfaitement intégrées à la logique du garde-corps. Ces fils captent la lumière avec finesse et offrent une expérience sensorielle unique, intensifiant la perception des déplacements dans ce grand volume vertigineux.
Et l’on pourrait évoquer encore la gare de Châtillon-Montrouge
(ouverture en 2026) par Périphériques architectes et avec l’artiste Laurent Grasso, où l’infrastructure se fait esthétique et sublime le moment du déplacement avec ses envolées d’escaliers, d’escalators et de passerelles traversantes. L’intervention artistique de Laurent Grasso est un ciel inspiré des tableaux de la Renaissance. L’une de ses peintures a été photographiée pour recomposer un fichier graphique. Celui-ci est appliqué sur les lames métalliques plissées formant un plafond de 800 m2 au-dessus du vide. Ainsi, quelle que soit la position du voyageur dans la gare, le ciel reconstitué l’accompagne vers la surface.
Une révolution urbaine et culturelle
Le Grand Paris Express s’affirme comme une œuvre collective où chaque station témoigne d’un dialogue étroit entre architecture, art et territoire. Sous-tendu par une attention constante aux contextes locaux et aux sensibilités des lieux, ce réseau constitue un projet unique en son genre. Une fois achevé, il offrira une expérience métropolitaine d’une richesse incomparable, où chaque gare se dévoilera comme une pièce maîtresse d’une vaste collection publique mêlant innovation urbaine et expression artistique. Paris, ville-monde dotée d’une influence économique, politique et culturelle majeure, ne pouvait ignorer l’importance de la culture dans cette transformation. Ce chantier monumental est porteur d’un défi de taille : tenir la promesse de faire coexister utilité publique et création artistique dans une harmonie qui transcende les contraintes techniques et budgétaires. Ce projet incarne un tournant pour la métropole, une opportunité de repenser les espaces publics et de redonner une place centrale à l’imaginaire collectif. Garder cette ambition intacte nécessitera un engagement sans faille pour que la culture, inscrite au cœur de cette initiative, continue de façonner un réseau où chaque passage, chaque lieu, devient une rencontre entre l’usager et une vision métropolitaine renouvelée.
Par Sophie Trelcat
Visuel à la une : Station Villejuif-Gustave Roussy, Dominique Perrault Architecture © Michel Denancé
— Retrouvez l’article dans Archistorm 131 daté mars – avril 2025