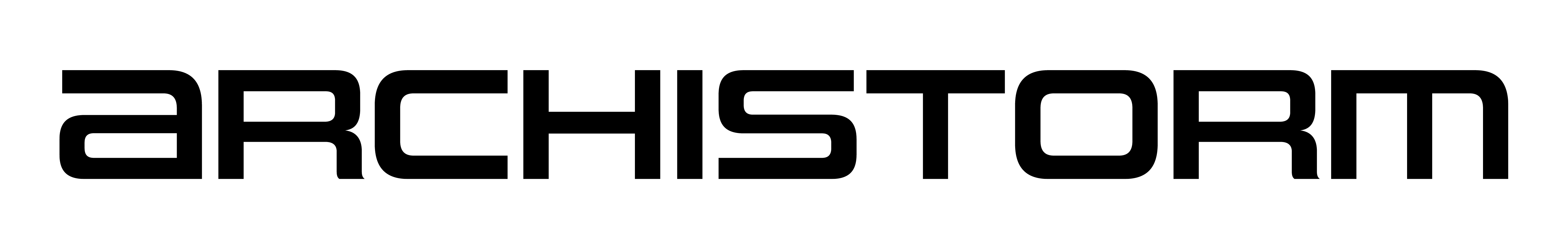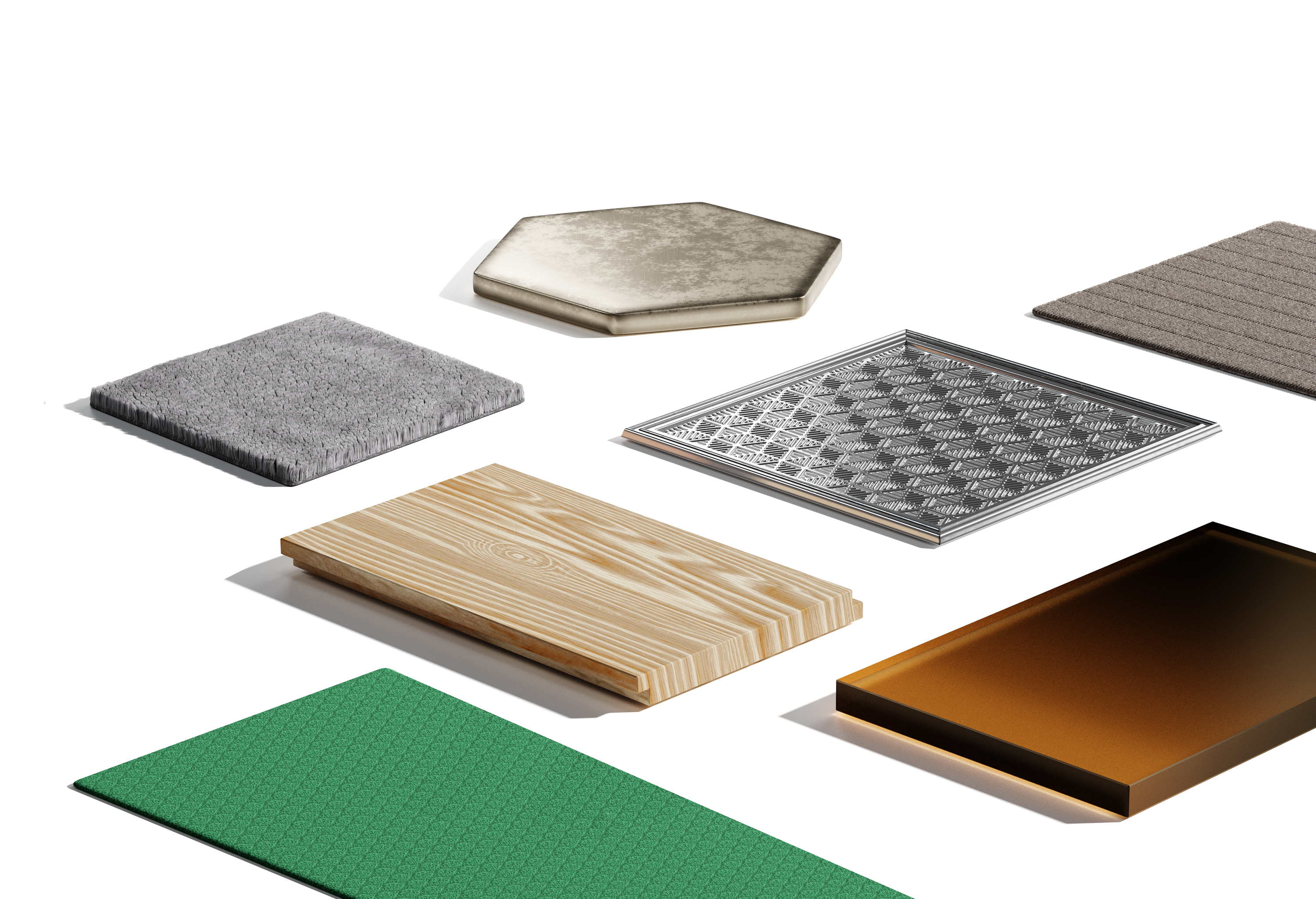Si leur agence est devenue une institution, impossible de les classer ou de les enfermer dans une case. Au gré d’une discussion passionnante, Jacques Ferrier et Pauline Marchetti révèlent leurs réflexions et savoir-faire, leur envie d’une ville dont l’intelligence ne se borne pas à la technique mais s’inscrit davantage dans une intelligence de la relation.
Votre agence considère la ville comme une possible contribution à l’équilibre écologique de la planète. Qu’entendez-vous par cela ?
Suite à la livraison du Pavillon France à l’Exposition universelle de Shanghai et à notre mission de conseil pour les gares du Grand Paris Express, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la ville, voire de la très grande ville. Cela nous a menés à un constat : « la ville a créé le problème, la ville doit trouver la solution ». Si les villes sont la cause principale des problèmes climatiques, elles sont originellement vertueuses : elles occupent 2 à 3 % des surfaces habitables de la planète pour loger plus de 50 % de la population, et permettent ainsi de concilier l’accroissement extraordinaire de la population mondiale avec une consommation raisonnable du territoire.
De plus, l’omniprésence de l’infrastructure technologique, grande consommatrice de ressources, constitue un axe d’action prometteur pour rendre la ville plus désirable.
Votre agence, basée en France et en Chine, intervient sur des sujets très variés : bâtiments publics, institutionnels, culturels, industriels, projets de mobilités… Abordez-vous finalement chacun des sujets que vous traitez via une méthodologie commune ou une approche similaire ?
Nous assumons une vocation et un plaisir d’être touche-à-tout. Notre curiosité nous rapproche : c’est pourquoi nous enseignons, écrivons, et avons notamment créé en 2010 un studio de réflexion intégré à l’agence – Sensual City –, au sein duquel nous abordons des problématiques diverses qui nourrissent les projets. Nos recherches font l’objet de publications, de conférences et de communications dans des colloques ou journées d’études.
Cette démarche ne convient pas tout à fait au modèle économique actuel, mais il s’agit d’une approche à laquelle nous aspirons, celle que nous revendiquons : favoriser un mode de transversalité dans notre travail.
Il s’agit également d’une forme de résistance à une direction qu’est en train de prendre le marché immobilier, qui considère l’architecture comme un produit. Or, la qualité de l’espace ne peut pas être associée à l’idée de produit, qui abolit la pensée, la réflexion, l’innovation.
Pouvez-vous nous parler davantage de la démarche initiée avec Sensual City ?
Dans le cadre de nos réflexions, nous défendons l’idée qu’au-delà de ses performances environnementales essentielles, le futur de la ville réside aussi dans la relation qu’elle entretient avec ses habitants. Nous subissons une telle saturation et une technicisation tellement importante dans l’espace urbain aujourd’hui que la ville devient source d’anxiété. Le projet de la Ville Sensuelle réside dans l’établissement d’une relation sensorielle avec la ville : respirer de l’air pur, écouter des bruits de la ville plutôt que le vacarme des voitures, etc. Aussi avons-nous regroupé sous le nom Sensual City toute notre activité de recherche. Il ne s’agit en aucun cas de nostalgie mais d’une prise au sérieux de nos sens, pour favoriser le passage d’une technologie écrasante, oppressante, à une technologie subtile, qui s’efface.
Existe-t-il, selon vous, une architecture idéale ?
Peut-être faut-il se dire qu’heureusement, elle n’existe pas ! La critique principale que nous faisons au modernisme est d’avoir sublimé le progrès : parce qu’elle est idéale, l’architecture moderne peut s’appliquer à toutes les situations, à toutes les cultures et à tous les pays. Les bâtiments dits « iconiques » continuent à parsemer le monde mais procèdent, en réalité, de cette vision d’une esthétique idéale, pouvant indifféremment être construite dans des villes comme Singapour, Paris ou New York. Nous pensons qu’il faut combattre cette idée d’une architecture idéale, conduisant fatalement à une triste monotonie.
Existe-t-il une figure de l’architecture que vous aimeriez saluer à travers cette interview ?
Le couple Charles et Ray Eames continue de nous inspirer. Ce sont, précisément, des touche-à-tout. La Eames House représente notamment une inspiration formidable. La légende raconte qu’ils ont revu les dessins de leur maison lors de la livraison des poutres et poteaux sur le chantier : ils sont parvenus à réaliser un volume construit plus grand avec seulement une poutre supplémentaire. Nous aimons ce raisonnement qui ne limite pas la conception au plan, mais invite les décisions de conception à toutes les phases du projet. De formation design et beaux-arts, ils ne cochaient pas la case architectes !
Par Annabelle Ledoux
Visuel à la une : Îlot mixte Tour Lumière, Tours, Ferrier Marchetti Studio © Myr Muratet
— Retrouvez l’article dans Archistorm 131 daté mars – avril 2025