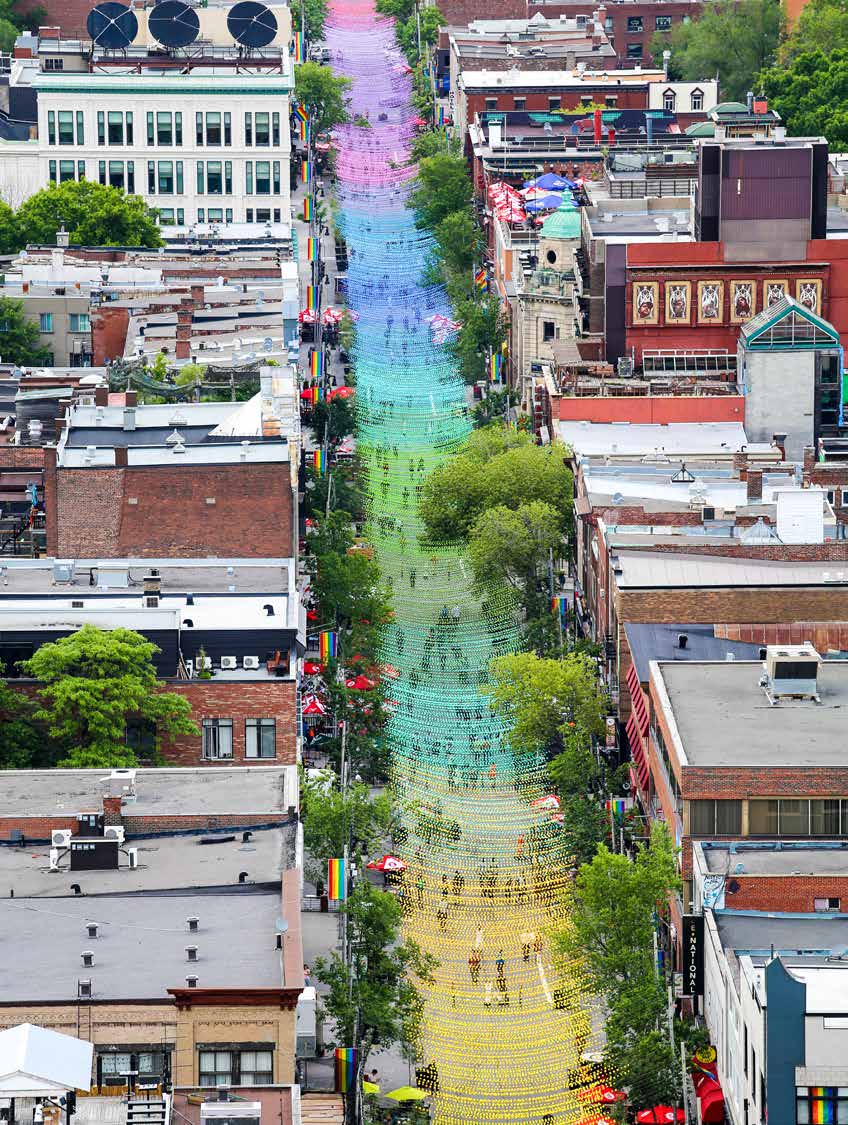Les nationalismes qui essaiment un peu partout dans le monde actuellement s’expriment rarement par l’architecture. Et pour cause : le travail a, en Europe du moins, été largement mené à la fin du XIXe siècle et au début du XXe avec une étonnante inventivité et des visées plus émancipatrices que protectrices. Budapest en est l’un des meilleurs exemples.
Dans le prolongement du printemps de 1830, le tournant du siècle voit se poser à l’échelle mondiale la question des nations : leur construction comme leur déconstruction et leur reconstruction sont en jeu. Les historiens, tel l’Anglais Benedict Anderson, définissent la nation comme une communauté humaine dans laquelle des individus se sentent unis par des liens à la fois matériels et spirituels. Plus qu’une région, la nation n’est pas nécessairement un État ; elle cherche toutefois à atteindre un stade d’indépendance politique, phénomène qui se manifeste avec une particulière vigueur en Europe autour de 1900. C’est à ce moment-là que la Finlande, la Hongrie, la Roumanie ou encore la Catalogne, dont la culture avait déjà connu un premier éveil, expriment une part de leur singularité au moyen de l’architecture, qui prend alors un exceptionnel essor. Une telle mutation passe dans tous les cas par un regard sur l’histoire, une réflexion identitaire qui inscrit la nation dans un régime d’historicité. En associant des éléments de leur folklore à une absorption accélérée des acquis de la révolution industrielle, les jeunes nations européennes proposent alors le premier style international du XXe siècle : l’Art nouveau.

Depuis sa création en 1867, grâce aux lois de compromis entre Autriche et Hongrie, et jusqu’à 1892 – date à laquelle Budapest obtient le rang de capitale et de résidence royale –, l’Empire austro-hongrois, au sein duquel plus de dix langues sont parlées, reste dominé par une dynastie, les Habsbourg, et une capitale, Vienne. La puissance de cette dernière s’incarne dans le monumental Ring, boulevard ceinturant la ville médiévale et loti jusqu’à la fin du siècle d’un chapelet de monuments unique en son genre. Cet urbanisme des bâtiments publics et des symboles du pouvoir se diffusera largement en Europe centrale, et c’est également à l’échelle métropolitaine que la Hongrie inscrit, en premier lieu, son désir d’identité et d’indépendance : la modernisation urbaine de la capitale magyare, engagée en 1873 avec la fusion de Buda et de Pest, passe ainsi par d’importants projets d’architecture et d’aménagement.
Fondateur, le pont des Chaînes franchissant le Danube est certes l’œuvre d’architectes et ingénieurs britanniques, William Tierney Clark et Adam Clark (1839-1849) ; viendront ensuite l’Académie hongroise des sciences, œuvre du prolifique architecte prussien Friedrich August Stüler (1865), puis – par des nationaux cette fois – l’opéra royal signé Miklós Ybl (1884), le parlement d’Imre Steindl (1885-1902) ou encore le pont Erzsébet de Pál Sávoly (1903). Par son écriture, chacun prolonge encore la tradition éclectique européenne, dont le parlement pousse la version néogothique à un très haut degré d’expression et de raffinement. Dans les faits, toutefois, le sentiment national hongrois s’est exprimé bien plus tôt, avec la création, dès 1808, d’un musée national, plusieurs décennies avant la construction du bâtiment néoclassique qui l’accueille aujourd’hui ; puis dans les années 1820 avec la réactivation de la langue populaire, longtemps oubliée au profit de l’allemand ou du latin. Mais si la révolution de 1848-1849, réprimée par l’Autriche avec l’aide de la Russie, a eu pour effet de consolider ce sentiment, elle en a également différé les expressions les plus originales.

© Simon Texier
Sur le plan des formes, le tournant ne s’opère en effet qu’à partir des années 1890 lorsque, répondant à l’appel de József Huszka et son ouvrage Créons un vrai art appliqué hongrois, architectes et décorateurs commencent à puiser une part de leur inspiration dans les motifs de la broderie locale, plus particulièrement celle des vêtements de gala. Loin de cantonner le style magyar à son territoire, ce regain d’intérêt ouvre au contraire la Hongrie vers l’est, vers ses lointaines origines perses, assyriennes et même hindoues – que l’on retrouvera par exemple sur la façade du théâtre-cinéma Urania (1899). L’exposition du Millénaire de la Hongrie, en 1896, arrive à point nommé et précipite l’affirmation d’une architecture nouvelle : le musée des Arts décoratifs, conçu par le chef de file du style national hongrois, Ödön Lechner – qui a travaillé à Paris et étudié le phénomène d’hybridation que fut la Renaissance française –, intègre de manière organique des éléments de la construction populaire associés à des motifs asiatiques, auxquels l’architecte renoncera pour l’Institut de géologie (1897) comme pour la Caisse d’épargne de la poste (1900-1901). Cette dernière est dotée d’une toiture polychrome qui devient l’un des éléments distinctifs de la période, tandis que son sommet, orné de têtes de taureaux, fait référence au « trésor d’Attila » récemment découvert et dont l’ancienneté (IXe-Xe siècles) a opportunément apporté la preuve d’un art et d’une culture magyars profondément ancrés. Attila est encore représenté en mosaïque dans cet autre manifeste, hors les murs cette fois, de l’art hongrois qu’est le pavillon de la Biennale de Venise, inauguré en 1909.
Revisitant le folklore local, mais attentive aux mouvements sécessionnistes qui émergent dans les capitales européennes, une école informelle s’organise autour d’Ödön Lechner – à défaut de la structure qu’il réclamait, il enseigne le soir dans les cafés –, dont se détachent les frères József et László Vágó. Emblématiques du renouveau hongrois, leurs réalisations, comme l’immeuble Gutenberg construit pour le syndicat des imprimeurs et des typographes (1906), brillent tant par la concision de leurs lignes que par la subtilité de leur répertoire décoratif. Une architecture plus nettement inspirée de l’Art nouveau émerge également, mais dont l’iconographie n’oublie pas de célébrer les gloires nationales, tels István Széchenyi et Lajos Kossut ; c’est le cas du siège de la banque Török, signé Henrik Böhm et Armin Hegedüs (1906), dont le couronnement est occupé par une mosaïque de Miksa Róth intitulée Gloire à la Hongrie. On retrouve Miksa Róth parmi les artistes conviés par Henrik Schmahl, auteur du très cosmopolite Párisi Udvar (1909-1913), immeuble commercial récemment transformé en hôtel. Ici les références italiennes, parisiennes et orientales sont subtilement mêlées et produisent un édifice qui aurait parfaitement trouvé sa place dans les rues de Manhattan. Preuve s’il en est que le moment 1900 fut, pour Budapest, celui d’une intense exploration, d’une convergence de formes qui contredisent au fond toute idée d’une pureté des styles nationaux.
Texte : Simon Texier
Visuel à la une : © Simon Texier
— retrouvez l’article sur Budapest, fin de siècle : architecture nationale ou nationaliste ? dans Archistorm 121 daté juillet – août 2023 !