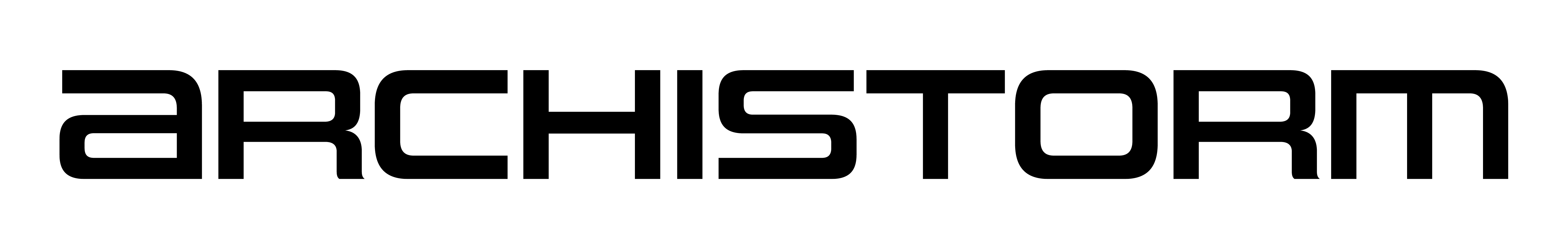Dans le 6e arrondissement de Paris, l’ancien siège de la MAIF situé au 87 rue Notre-Dame-des-Champs a été acquis par l’Université Paris-Panthéon-Assas. L’édifice a fait l’objet entre 2018 et 2024 d’un projet de réhabilitation et d’extension porté par l’agence B+A. L’histoire du 87 Notre-Dame-des-Champs a été complexe à retracer. L’agence a travaillé à l’étude de l’édifice in situ et en archives, pour découvrir son histoire architecturale et technique. Inauguré en 1958, le bâtiment avait subi des transformations qui avaient modifié son apparence. Les objectifs du projet ont consisté à restaurer la cohérence de cette architecture, à favoriser son insertion en site urbain et à apporter une nouvelle valeur d’usage aux anciens bureaux. La restructuration a ainsi permis d’établir 3 000 m2 de locaux d’enseignement et quatre logements en surélévation.
« Le récit de la continuité »
L’agence B+A adopte sur l’ensemble de ses projets une approche respectueuse du contexte et de l’histoire des lieux. Une étude attentive de l’existant permet d’identifier les caractéristiques essentielles de chaque édifice et de définir leur potentiel de transformation.
Ce projet de réhabilitation et d’extension incarne donc pleinement la philosophie de l’agence basée sur « le récit de la continuité ». En effet, pour ses architectes, le dialogue historique et interculturel est essentiel, l’approche de B+A valorise donc de manière réfléchie les éléments historiques, les ressources et les spécificités fonctionnelles et esthétiques en faveur de l’élaboration de projets respectueux tout en répondant aux besoins contemporains.
L’histoire du 87 Notre-Dame-des-Champs est par ailleurs complexe à retracer. L’agence a longuement travaillé à l’étude de l’édifice in situ et en archives, à la découverte de son histoire à la fois architecturale et technique. Ces recherches ont permis d’établir une chronologie du bâtiment.
« Ce projet incarne une vision : celle d’une université résolument ancrée dans son environnement, capable de répondre aux enjeux académiques, écologiques, économiques et sociétaux. »
— Stéphane Braconnier, président de l’Université Paris-Panthéon-Assas
Histoire de l’ancien bâtiment industriel
Conçu à partir de 1954 par deux disciples d’Auguste Perret, Christian Édouard-Lambert et Jean-Pierre Epron – qui signe là sa première œuvre –, l’édifice constitue un témoin de l’architecture moderne d’après-guerre.
La structure en béton exécutée par l’entreprise Perret se distingue par des caractéristiques techniques innovantes. Les planchers nervurés de seulement 5 cm d’épaisseur et l’emploi de potelets biseautés témoignent d’une démarche rationaliste et illustrent une époque à laquelle l’économie de matière primait.
Ce bâtiment de deux étages accueillait initialement le siège de l’imprimeur Marinoni et abritait de lourdes machineries, avant de changer de propriétaire et de subir diverses transformations. À la fin des années 1970, il est converti pour devenir le siège de la compagnie d’assurances de la MAIF. La façade d’origine est adaptée au profit d’un mur-rideau avec habillage en travertin, l’intérieur est entièrement restructuré en bureaux et la structure est modifiée.

Nouvel usage des lieux
Face à un manque de cohérence globale, le projet de transformation de l’agence B+A propose de recouvrer l’identité architecturale du bâtiment d’origine et de l’adapter au programme universitaire en répondant aux besoins d’accueil de l’établissement.
La distribution globale a été pensée pour répondre aux flux générés par les étudiants. La restructuration permet d’établir 3 000 m² de locaux d’enseignement de l’université, avec des salles de cours, des bureaux, une bibliothèque centre d’études, des locaux dédiés aux chercheurs, un auditorium ainsi que des espaces conviviaux et deux cafétérias respectivement destinées au personnel et aux étudiants, ouvertes sur une terrasse commune.
« Le scénario retenu pour cette opération consiste en la transformation d’un immeuble de bureaux en une école sur son socle et des logements dans son couronnement. L’enveloppe et l’intérieur du bâtiment ont été retravaillés en profondeur pour permettre d’accueillir ces nouveaux usages, tout en respectant les normes en vigueur. »
— Adrien Berenger, Directeur Adjoint Asset Management, Pôle Institutionnel France, La Française REM
Adapter et valoriser l’existant
Le bâtiment existant est conservé dans sa totalité, le programme comprend sa transformation complète et repose en cela sur plusieurs interventions majeures.
Le creusement du patio permet de créer un puits de lumière éclairant tous les niveaux, jusqu’au sous-sol qui abrite le centre d’études. Les anciens plateaux de bureaux ont été décloisonnés et redistribués dans une logique de modularité, afin de s’adapter aux besoins futurs. La rampe d’accès a été comblée et le parking souterrain réhabilité pour créer de la surface noble. Enfin, une surélévation de trois niveaux permet de maximiser l’espace et de créer quatre logements, ce qui s’inscrit dans une logique de densification maîtrisée du tissu parisien.
En ce qui concerne le parti architectural, la structure poteau-poutre en béton a été préservée. Les habillements de façade ajoutés au cours des années 1970 ont été démontés pour restituer la modénature et rendre à l’édifice son dessin d’origine. Le nouvel aspect est volontairement sobre et privilégie des teintes claires pour souligner les façades historiques et respecter l’esthétique architecturale du quartier.
La surélévation prolonge la trame verticale du bâtiment, elle conserve la volumétrie de la façade sur deux niveaux puis se place en retrait sur le niveau d’attique. Le choix d’une structure légère en acier-bois préfabriquée répond à des contraintes de portée tandis que le bardage en aluminium natu-
rel, créant un jeu de reflets avec le ciel parisien et faisant écho aux toitures en zinc, a été choisi pour sa discrétion visuelle.
Approche environnementale et solutions bioclimatiques
L’approche environnementale vise à minimiser l’impact écologique du bâtiment. La conservation de la structure existante a permis de préserver les éléments d’origine. Le recours à des procédés de construction sèche et à la préfabrication a permis de limiter les déchets et de réduire l’empreinte carbone du chantier. Ces solutions ont également facilité une mise en œuvre rapide et ont permis de limiter les nuisances sonores durant les travaux.
Le projet paysager comprend la perméabilité et la végétalisation de la parcelle dans l’objectif de favoriser la percolation des eaux pluviales, et celles qui ne peuvent pas être infiltrées sont récupérées pour alimenter les réservoirs des sanitaires. Le patio est également végétalisé afin de constituer un îlot de fraîcheur, les toitures libérées d’emprises techniques sont plantées de prairies fleuries avec graminées et les terrasses accessibles de couvre-sol et de plantes aromatiques.
Enfin, le projet intègre des solutions bioclimatiques contribuant à l’optimisation de la gestion naturelle de la lumière, de la chaleur et de la ventilation afin d’assurer performances énergétiques et durabilité du bâtiment dans son ensemble.

Entretien avec Michaël Fellmann et Yvan Icart, Architectes, Gérants et Stéphane Delaby, Architecte, B+A Architectes
Quels sont les principes qui ont permis de définir les actions de réhabilitation effectuées sur cet édifice historique ?
Pour comprendre l’histoire du bâtiment et ses caractéristiques techniques, nous avons procédé à une analyse in situ des éléments constructifs, visibles lors du démontage des plafonds afin de mieux comprendre les différentes phases de construction et leurs spécificités. Des recherches complémentaires ont été menées par le service du DHAAP de la ville de Paris, confirmant nos hypothèses. Ces découvertes ont permis de dégager un récit cohérent sur l’évolution du bâtiment.
Nous avons constaté une grande hétérogénéité des éléments de structure. Les planchers nervurés en béton, caractéristiques des constructions industrielles de l’après-guerre, cohabitent avec des planchers hourdis et des dalles pleines, témoignant de modifications successives. Cette superposition compliquait la compréhension de la structure et a nécessité une analyse plus approfondie visant à garantir la faisabilité des transformations envisagées.
Entretien avec Catherine Reynaud, Direction Déléguée Région Île-de-France, Directrice Pôle Immobilier Tertiaire, Demathieu Bard Immobilier
En quoi ce projet de réhabilitation s’inscrit-il dans la stratégie du groupe ?
Nous agissons en tant que promoteur adossé au groupe de construction Demathieu Bard. Notre expertise couvre tous les types de produits, avec une prédilection pour des opérations de taille moyenne. Nous œuvrons à l’échelle nationale. Nos projets suivent une logique en trois temps d’achat, de transformation puis de revente dans l’objectif de créer de la valeur d’usage.
La réhabilitation d’immeubles tertiaires, notamment en Île-de-France, reflète parfaitement cette approche. Dans le cadre de l’immeuble situé rue Notre-Dame-des-Champs, nous avons exploité la constructibilité résiduelle grâce à une surélévation accueillant des logements et à l’aménagement des sous-sols, jusqu’alors destinés au stationnement automobile, qui n’avaient plus de sens dans une ville qui privilégie les mobilités douces.
Notre stratégie consiste aussi à questionner les usagers afin de répondre aux demandes spécifiques et de rester en adéquation avec le marché local. Pour ce projet en particulier, l’Université d’Assas, propriétaire des édifices voisins, a trouvé dans notre projet une opportunité pour installer des locaux d’enseignement adaptés à ses besoins.
Enfin, il est essentiel pour nous de développer des projets attractifs pour les investisseurs. Cela passe par une attention accrue aux performances environnementales afin de contribuer à une ville plus vertueuse et durable, mais aussi à la cohérence avec l’environnement urbain.
Fiche Technique :
Maîtrise d’ouvrage : Demathieu Bard Immobilier
Investisseur : La Française Real Estate Managers
Maîtrise d’œuvre : B+A Architectes, Mandataire
Bureau d’études TCE : SAS Mizrahi
Programme : Reconversion d’un immeuble de bureaux en réhabilitation – restructuration – extension pour y installer des locaux d’enseignement supérieur de l’Université Paris-Panthéon-Assas et 4 logements en accession
Surface : 3 770 m2 dont 3 220 m2 enseignement et 550 m2 logements
Budget : 12,3 M € HT
Par Cléa Calderoni
Toutes les photographies sont de : © Sergio Grazia
— Retrouvez l’article dans Archistorm 131 daté mars – avril 2025